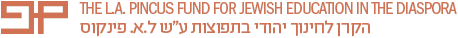Les insultes proférées contre Christiane Taubira signifient-elles un “retour de la France raciste” ? L’historien des idées (*) fustige cette idée reçue.
Le Point : Dans une tribune au Monde, le journaliste Harry Roselmack a dénoncé “le retour de la France raciste”. “Ce qui me chagrine, écrit-il, c’est le fond de racisme qui résiste au temps et aux mots d’ordre, pas seulement au sein du FN, mais au plus profond de la société française. C’est un héritage des temps anciens, une justification pour une domination suprême et criminelle : l’esclavage et la colonisation (…). Si on était capable de lire l’inconscient des Français, on y découvrirait bien souvent un Noir naïf, s’exprimant dans un français approximatif, et dépourvu d’histoire ou, tout du moins, d’oeuvre civilisatrice.” Qu’inspire ce diagnostic à l’auteur du Dictionnaire historique et critique du racisme ?
Pierre-André Taguieff : Il s’agit là de déclarations si générales qu’elles auraient pu être publiées telles quelles il y a dix, vingt ou trente ans. L’annonce du “retour de la France raciste” est régulièrement faite depuis l’épisode poujadiste, en référence à Vichy ou aux années trente. Dans ces diagnostics fabriqués sur le modèle du “retour du racisme” ou de sa “résurgence”, on reconnaît aussi la thèse, très répandue dans les milieux antiracistes organisés, du “racisme institutionnel”, postulant que la société tout entière est intrinsèquement raciste, en raison de sinistres héritages dont la persistance serait irrémédiable. On n’a donc pas à s’étonner de tels “retours”. Aussi sincère soit-il dans l’expression de son émotion, ce journaliste croit pouvoir dénoncer une nouvelle poussée deracisme anti-Noirs en s’appuyant sur une base factuelle plus qu’insuffisante. Ces propos relèvent d’un genre de discours impressionniste très répandu, qui consiste à dénoncer un “climat” ou une “atmosphère” idéologique. Ceux qui dénoncent une nouvelle poussée de racisme anti-Noirs ne font que réagir avec émotion à l’actualité. Aucune étude fondée sur des enquêtes récentes ne permet de conclure dans ce sens.
Il n’y a pas, aujourd’hui en France, une vague de racisme anti-Noirs. Dans son dernier rapport publié en mars 2013, la Commission nationale consultative des droits de l’homme a établi qu’en 2012, si l’on considère à la fois les actes et les menaces, la violence antisémite a considérablement augmenté (+ 58 %), la violence antimusulmane poursuivant sa hausse (+ 28 %), tandis que “leracisme et la xénophobie connaissent une relative stabilité, avec une augmentation de 2 %”, les “personnes d’origine maghrébine” en étant “les principales victimes”. L’analyse de l’évolution des faits anti-Juifs (actions violentes et menaces confondues), recensés en France de 1999 à 2012, montre une augmentation brutale de la judéophobie au début des années 2000, avec des “pics” en 2000, 2002, 2004, 2009 et 2012. En 1999, on recensait 82 faits anti-Juifs, en 2000, 744, en 2009, 815, en 2011, 389, et en 2012, 614. Sur la base de ces données, certains observateurs pourraient déplorer un “retour de la France antisémite”. Il s’agit, plus exactement, de l’apparition d’une nouvelle vague anti-juive, alimentée par un endoctrinement “antisioniste” provenant de diverses sources.
Et Christiane Taubira ? N’est-elle pas victime d’un racisme anti-Noirs ?
Victime d’injures racistes aussi odieuses que grossières, Christiane Taubira est moins visée en tant que “Noire” qu’en tant que ministre devenue emblématique de la gauche au pouvoir, frappée d’une impopularité croissante. Ce qui est vrai, c’est que les vieux stéréotypes anti-Noirs jouant sur la métaphore simiesque ressortent régulièrement. C’est de l’insulte toute faite, du genre de celle qui se diffuse massivement sur le Web. Mais on constate que ces attaques racistes sont unanimement condamnées, à quelques marginaux extrémistes près. Parmi les nombreux Français qui jugent Mme Taubira incompétente et irresponsable, donc “dangereuse”, il en est très peu qui approuvent les attaques racistes contre elle. Si la société française était sous l’emprise de passions négrophobes, la situation serait fort différente.
“Je préfère la voir dans un arbre après les branches que l’avoir au gouvernement”, a déclaré une tête de liste FN aux municipales, depuis suspendue, à propos de Christiane Taubira. Quelques jours plus tard, la ministre de la Justice s’est fait traiter de “guenon” par une gamine de douze ans lors d’une manifestation contre le mariage pour tous. Enfin, l’hebdomadaire Minute l’attaque grossièrement à la une en reprenant les mêmes thèmes (“singe”, “banane”). N’y a-t-il pas une “banalisation de la parole raciste”?
Quelques injures racistes flagrantes, aussi intolérables soient-elles, ne permettent pas d’établir un tel diagnostic. La dénonciation de la “libération” ou de la “banalisation de la parole raciste” est un lieu commun de la rhétorique antiraciste, et ce, depuis longtemps. De tels modes de stigmatisation sont régulièrement constatés, et parfois sanctionnés, notamment depuis la loi du 1er juillet 1972. Il n’y a ici rien de nouveau, hormis la fonction de la cible, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Encore y a-t-il des précédents. Faut-il rappeler les violentes attaques antisémites lancées contre Pierre Mendès France à l’époque du poujadisme ou contre Simone Veil au moment des débats sur la dépénalisation de l’IVG, qui se sont poursuivies longtemps après la promulgation, le 17 janvier 1975, de la “loi Veil” ? Ou encore, à la une de Minute le 4 novembre 1992, exploitant l’affaire du sang contaminé, la caricature antisémite de Laurent Fabius, représenté en vampire au nez crochu et aux griffes sanguinolentes ? L’opération infâme de l’hebdomadaire Minute, titrant à la une “Maligne comme un singe, Taubira retrouve la banane”, doit être condamnée et sanctionnée. Elle ne saurait cependant être assimilée à un appel au lynchage par une version française du Ku Klux Klan. Ni même à un lynchage médiatique, qui suppose la participation de la quasi-totalité des organes de presse à l’opération. Ce qui n’est pas le cas, et l’on s’en réjouit pour la ministre.
Christiane Taubira estime que les insultes dont elle est l’objet relèvent d’une “attaque au coeur de la République”…
C’est également un cliché, auquel recourent tous les élus ou les membres de l’exécutif lorsqu’ils sont attaqués. Le président de la République, face aux huées qui le poursuivent, déclare ainsi que “c’est la République que l’on vise”. Méthode d’autotransfiguration : “Moi, la République”. C’est supposer qu’on ose s’attaquer au sacré à travers lui. C’est en même temps suggérer que toute critique de sa politique relève du sacrilège. Le 12 novembre 2013, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, oubliant la spécificité raciste de l’attaque contre la ministre de la Justice, a déclaré à l’Assemblée nationale : “Quand on s’attaque à Christiane Taubira, c’est sûrement une blessure personnelle, mais c’est aussi une fonction que l’on attaque et c’est la République que l’on abîme.” Il aurait dû dire : “Quand on s’attaque de cette manière à Christiane Taubira…” Mais il a mis en cause toute attaque contre elle, la transformant en personne située au-delà de la critique, faisant d’elle une intouchable, une icône vouée à l’admiration, voire à la vénération. Comme si les critiques contre les ministres de son gouvernement étaient par nature racistes, assimilables à des sacrilèges. On croyait qu’une telle vision était le propre des islamistes les plus obtus et les plus fanatiques.
La réalité est autre, plus prosaïque : les injures et les huées visent un gouvernement de plus en plus impopulaire, en raison des effets de sa politique. Ce rejet de la gauche au pouvoir, les violences sociales l’expriment d’une façon plus significative. Les “Bonnets rouges” et les mouvements contestataires du même type témoignent de l’orage, fait d’inquiétude, de désespoir et de colère, qui balaie la société française. S’attaquent-ils, eux aussi, à “la République” ?
L’acharnement contre la ministre de la Justice a suscité dans un premier temps une molle indignation dans la classe politique. Dans un éditorial intitulé “Taubira, la banane et les dérives du politiquement incorrect”, le directeur duMonde des livres, Jean Birnbaum, écrit : “Quelqu’un, quelque part, prononce une parole raciste, misogyne ou homophobe; or, témoin de tels propos, chacun préfère la boucler; l’ouvrir, ce serait s’exposer au grand ricanement de l’époque : “Marre du politiquement correct ! ; protester, ce serait risquer le pilori”. Au nom de la dénonciation du politiquement correct, ne tolère-t-on pas les pires discours ?
C’est une dérive qu’on peut craindre et un travers socialement observable. Toute vertu, toute idée noble peut devenir l’instrument d’un terrorisme intellectuel. On connaît le principe de la dérive : au nom de la liberté d’expression et de la tolérance, refuser toute limite de l’une ou de l’autre, et, en conséquence, donner dans l’intolérable, ou l’accepter. Certains se couvrent du rejet justifié du politiquement correct pour faire du politiquement incorrect une orthodoxie. Ce qui est inacceptable. Mais on n’en peut conclure logiquement que la censure et l’autocensure, que visent à établir les tenants du politiquement correct, sont d’excellentes choses. Encore moins qu’une chasse aux sorcières lancée contre les anti-Taubira et les anti-Hollande les plus bruyants ou les plus virulents constitue un bon traitement du malaise social. Cette affaire, à l’évidence orchestrée et exploitée par une gauche sur la défensive, pourrait finir en pantalonnade.
La République n’est pas aujourd’hui menacée par des ligues factieuses, comme elle le fut entre 1934 et 1936. Ce qui se banalise, en France, ce n’est pas “le racisme“, qui tout au contraire s’est débanalisé dans la période post-nazie, ni “la parole raciste”, qui n’a jamais cessé de se raréfier, à chaque génération, depuis qu’elle est devenue socialement visible et culturellement identifiable, et bien sûr condamnable. Dans le paysage médiatique français, ce qui frappe, c’est la banalisation de l’indignation, qui est pour beaucoup une indignation de complaisance et de convenance. Une indignation antiraciste aussi consensuelle qu’hyperbolique, mue par une surenchère permanente. Mais une indignation sélective, visant un petit nombre de cibles, toujours les mêmes. Avec un effet pervers caractérisé : la répétition des mêmes cris d’indignation dans un consensus sans faille engendre une perte de force rhétorique. Ce discours répétitif mobilise de moins en moins. C’est qu’il n’incite à rien d’exaltant (une pétition, un manif ou un meeting de plus). Il sombre dans le bruit de fond du temps qui passe, et s’efface dans le brouillard du conformisme idéologique. La récitation du catéchisme des indignés provoque l’ennui, suscite une lassitude même chez les récitants, et cela se perçoit, s’entend dans les déclarations figées, se lit dans les formules sloganiques. L’indignation convenue meurt des effets de sa monotonie.
Jean-François Copé a reproché à Christiane Taubira de ne pas l’avoir soutenu lorsqu’il a été l’objet d’attaques antisémites. N’assiste-t-on pas à une surenchère dans la victimisation ?
Ce n’est pas la première fois que Jean-François Copé, comme Nicolas Sarkozy avant lui, est victime d’attaques antisémites. Or, elles ne provoquent aucune indignation médiatique, comme s’il y avait de bonnes et de mauvaises victimes des haines à base ethnique. L’inégalité dans le traitement médiatique des deux affaires est flagrante. On a là une parfaite application du principe “deux poids, deux mesures”. Faut-il en conclure que l’antisémitisme paraît moins inacceptable que le racisme anti-Noirs ? Ou bien qu’à droite, on se soucie moins de se mettre en scène en tant que victime et objet de compassion ? Ou encore, que la droite est moins versée dans l’art d’exploiter politiquement les injures racistes ?
Le discours antiraciste n’est-il pas devenu inopérant ?
Il a le mérite de rappeler des principes, des idéaux, des normes, ceux des sociétés “ouvertes” et des démocraties pluralistes. Mais, en se figeant, en devenant une langue de bois, il perd une grande partie de sa crédibilité. Le moulinage rhétorique de clichés et de slogans n’est guère attractif. Les mobilisations antiracistes ressemblent à des fièvres de courte durée. Le temps d’une manif, d’un meeting ou d’un concert gratuit. Depuis 1983-1984, les organisations antiracistes répètent que leur objectif est de faire disparaître le Front national de la scène politique. Leur échec est aussi flagrant que révélateur. Leurs dénonciations diabolisantes ne sont pas seulement inefficaces, elles paraissent participer à la construction du mouvement lepéniste et renforcer son dynamisme. En outre, les militants qui ont professionnalisé l’antiracisme, ou plutôt tel ou tel antiracisme, tendent à remplacer la réflexion critique, l’analyse des situations, la volonté d’argumenter et le souci pédagogique par des appels à la répression et à la sanction. Le policier et le juge chassent le sociologue et le pédagogue. Quand on a dit que le racisme était un délit, on croit avoir tout dit. Enfin, l’action antiraciste, en érigeant le “racisme” en problème social et politique majeur, engendre une racialisation du débat politique, qui provoque une rivalité mimétique pour le monopole de la parole antiraciste, ainsi qu’une radicalisation des projets répressifs risquant de limiter abusivement le champ de la liberté d’expression. Paradoxe tragi-comique : le combat contre l’intolérance finit par se retourner en lutte pour élargir indéfiniment le champ de l’intolérable. Donc en combat pour l’intolérance. Voilà qui risque de donner à l’expression du racisme un parfum d’interdit.
Dans votre Dictionnaire historique et critique du racisme, vous allez jusqu’à parler des “conséquences indésirables d’un antiracisme devenu machine à exclure et à tuer socialement”. L’antiracisme serait donc un racisme inversé ?
Non, mais dans certains cas, l’antiracisme fonctionne de la même manière que le racisme qu’il prétend combattre. Notamment comme mode de stigmatisation qui, même si l’accusation n’est pas bien établie, entraîne la mort sociale du stigmatisé. L’accusation de “racisme” permet de disqualifier facilement un contradicteur, sans prendre la peine de répondre à ses arguments. En outre, depuis les années 1980, les instrumentalisations politiques de la “lutte contre le racisme” se sont banalisées. Chaque parti, chaque groupe de pression, voire chaque groupe religieux, culturel ou ethnique (“communauté”) a son “racisme” qu’il dénonce de préférence à tous les autres, jugés négligeables, insignifiants ou inexistants. Ceux qui privilégient la lutte contre l'”islamophobie” ne sont pas les mêmes que ceux qui sont particulièrement sensibles aux nouvelles formes de la haine anti-juive et veulent les combattre. Cette fragmentation conflictuelle de l’antiracisme favorise la rivalité ou la concurrence entre les organisations antiracistes, qui ont tendance à voir le racisme dans l’oeil de l’autre et à s’attribuer une pratique authentique des exigences antiracistes.
Vous montrez dans votre dictionnaire que l’antiracisme a toujours hésité entre plusieurs discours. Aujourd’hui, n’est-il pas tiraillé entre l’éloge des différences et le refus de celles-ci ?
L’idéologie antiraciste, surtout depuis les années 1960, oscille en permanence entre l’appel à respecter ou célébrer les différences de groupe et le rappel de l’impératif d’assimilation, impératif anticommunautariste qui est celui de la tradition républicaine d’origine jacobine. Elle se caractérise également par une tension interne entre l’idéal du métissage, biologique et culturel, qui va dans le sens de l’uniformisation ou de l’indifférenciation, et l’idéal de la “diversité”, qui bétonne et sacralise les différences groupales. Enfin, l’idéologie antiraciste ne cesse d’hésiter entre la lutte contre les inégalités et, au nom du “respect de l’autre”, la défense des identités ethniques, des spécificités culturelles, etc. S’ajoutent à ces contradictions les divisions liées à des allégeances politiques ou religieuses incompatibles, sources de conflits insurmontables (par exemple, entre antisionistes et pro-israéliens). C’est pourquoi un “front antiraciste” unifié est impossible.
Certains estiment que l’antiracisme actuel est utilisé pour neutraliser toute critique de l’immigration. Qu’en pensez-vous ?
C’est là en effet l’une des fonctions idéologiques négatives que remplit l’antiracisme contemporain : il fait pression pour interdire le libre examen des questions délicates ou sulfureuses, par exemple celle de l’immigration, et exerce en permanence une censure suspicieuse dans l’espace des débats publics. D’une façon générale, à quelques nuances près, les antiracistes communient dans l’adhésion à ce que j’appellerai l’immigrationnisme rédempteur, qui consiste à ériger l’immigration en fatalité intrinsèquement bénéfique, ou en méthode de salut pour une vieille nation épuisée. C’est sur la base d’une telle immaculée conception de l’immigration que certains antiracistes assimilent abusivement toute critique des flux migratoires incontrôlés à un indice de racismeou de xénophobie. Au point de laisser entendre que les 69 % de Français qui estiment qu’il y a “trop d’immigrés” en France (enquête CSA, décembre 2012) sont à classer parmi les racistes ou les xénophobes. En outre, comme ce pourcentage a progressé depuis 2009 (+ 22 points), on en infère que le racisme et la xénophobie “montent”. Ces interprétations abusives des résultats de sondages alimentent une vision catastrophiste de l’évolution de la société française, qui serait saisie par les “vieux démons” du racisme. Il reste à se demander qui a intérêt à diffuser cette vision d’une “France raciste”, et de plus en plus “raciste”.
“Tant que la droite et la gauche se contentent du thème de la République, sans prendre en compte les diversités de notre société, ethnicisée, il y aura des poussées de l’expression raciste”, estime le sociologue Michel Wievorka. Qu’en pensez-vous ?
Partisan du multiculturalisme, qu’il pense être “la solution”, Michel Wieviorka répète la même formule sentencieuse depuis plus de vingt ans. Il semble y croire. Ce qu’il ne voit pas, ou refuse de considérer, c’est que le surgissement de multiples formes de racismes ou d’ethnismes est une conséquence de la fragmentation multicommunautariste de la société française et du relatif épuisement du modèle républicain d’assimilation. La “diversité” n’est qu’une désignation euphémisante de la société multiraciale ou pluriethnique, société multiconflictuelle qui alimente les rivalités et les haines communautaires. Une fuite en avant dans la politique des identités ou dans l’illusion multiculturaliste ne peut qu’aggraver la situation. Il reste une voie, certes pavée de difficiles problèmes à résoudre : “régénérer” la tradition républicaine, ce qui implique de cesser d’invoquer “la République” comme une idole et de la repenser comme un projet collectif, orienté vers le bien commun, lui-même à redéfinir à l’époque de la mondialisation. Et le bien commun ne se réduit pas à un “vivre ensemble” de consommateurs normalisés et de membres de groupes ethniques qui se surveillent, se jalousent, se méprisent ou se haïssent. La citoyenneté est à réinventer.
À gauche, l’antiracisme n’est-il pas en train de remplacer l’anticapitalisme ?
Depuis le ralliement subreptice, sous Mitterrand, de la gauche non communiste à l’économie de marché et l’irruption du Front national sur la scène politique, facilitée par cette même gauche, l’antiracisme tend à se substituer au vieil antifascisme, centré sur les “résurgences” plus ou moins fantasmées du nazisme. L’antiracisme ne remplace pas l’anticapitalisme, il fait couple avec lui. Chacun de ces deux “ismes” a un contenu suffisamment flou pour pouvoir s’adapter aux situations nouvelles en se redéfinissant. Aujourd’hui, à gauche, l’anticapitalisme politiquement correct vise la seule financiarisation de l’économie, et l’antiracisme en vogue est celui qui privilégie la lutte contre certaines catégories de victimes (Maghrébins, Arabes, Africains ou “Noirs”, Roms, etc.), en en oubliant d’autres, les Juifs au premier chef, mais aussi les “Blancs” (Européens, chrétiens, “Français de souche”, etc.). En outre, lorsqu’elle est fortement contestée, la gauche gouvernante n’hésite pas à utiliser l’appel à lutter contre le racisme ou l’extrême droite comme tactique de diversion, non sans jeter la suspicion sur la droite.
Au printemps dernier, suite à un vote au Parlement, la France a supprimé le mot “race” de sa Constitution… tout en réaffirmant qu’elle “interdit et condamne le racisme“. N’y a-t-il pas là une contradiction ?
La contradiction est flagrante, et l’opération contre-productive. C’est le mariage de la bonne volonté antiraciste et de l’aveuglement, sous l’égide d’une tendance à légiférer frénétiquement et d’un moralisme autoritaire. Les deux principaux arguments avancés par les “éliminationnistes” sont les suivants : 1° le mot “race” est dénué de sens, car, dans l’état actuel des connaissances scientifiques, il ne correspond pas à une réalité génétique définissable; 2° le mot “race” est dangereux, car il reste chargé de préjugés et de stéréotypes qu’il est susceptible de transmettre; ce mot serait donc à jamais souillé par les usages racistes qu’on en a fait dans le passé, pour justifier l’esclavage moderne, le colonialisme et l’impérialisme occidental, le nationalisme xénophobe et la politique génocidaire nazie. “Race” serait donc un mot en lui-même impur et contagieux, à éviter : vision naïve du langage. Une idée fausse s’ajoute à ces deux arguments douteux : l’idée que toute différenciation et toute catégorisation des groupes humains alimenterait leracisme. C’est faire le choix de l’obscurantisme.
Que peut-on attendre de cette suppression ? Un recul du racisme ?
Si l’on pose la question de l’efficacité, on voit mal en quoi supprimer le mot “race” du texte de la Constitution française (ou dans les manuels scolaires, par exemple) contribuerait à la lutte contre le racisme. Tout d’abord, le mot “race” a de nombreux synonymes ou quasi-synonymes qu’il faudrait aussi supprimer. Il en va ainsi des mots “ethnie” ou “groupe ethnique”, “nation”, “culture”, “communauté”, etc. Et il y a un racisme sans référence à la “race”, que j’ai appelé naguère le néoracisme différentialiste et culturel. C’est la racialisation des représentations qui est le vrai problème, non l’usage d’un mot. Les mots “juifs”, “musulmans” ou “chrétiens” peuvent prendre un sens racial et désigner des “pseudo-races” ou des “quasi-races” à mépriser, rejeter ou exterminer.
Ensuite, en supprimant des mots, on ne supprime pas les idées qu’ils évoquent : s’interdire d’employer un mot ne revient pas à éliminer les représentations qui lui étaient associées, car elles le sont également à un grand nombre d’autres mots (“origine” ou “origine commune”, “filiation”, “hérédité”, “parenté”, “ascendance”, “ressemblance”, etc.). Un raciste n’a nul besoin du mot “race” pour exprimer sa haine ou son mépris. Il lui suffit de puiser dans le stock des images, métaphores et analogies qui bestialisent ou diabolisent certains groupes humains. Jouer de l’implicite et du sous-entendu a plus de force polémique que recourir à une catégorisation raciale explicite (du type “race inférieure”). Enfin, pour lutter contre le racisme, c’est-à-dire contre des attitudes, des comportements, des formes institutionnelles (discriminatoires, ségrégationnistes, etc.), ainsi que des dogmes idéologiques, il faut bien pouvoir les désigner et les qualifier en tant que “racistes”. On conservera donc le mot “racisme“, alors même qu’il dérive du mot “race” qu’on a prohibé. Inconséquence. Pour être cohérents, les “éliminationnistes” auraient dû proposer aussi la suppression des mots “racisme” et “antiracisme” dans les textes officiels. Ils ont su s’arrêter à mi-chemin sur la voie de l’absurdité.
Le Point, Jeudi 28 novembre 2013