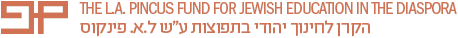Dans Les Nègres, en 1948, Jean Genet s’interrogeait en ces termes : « Mais qu’est-ce que c’est donc, un Noir ? Et d’abord, c’est de quelle couleur ? » Un ouvrage collectif, à paraître au début du mois de novembre aux éditions La Découverte, déplace la question en se demandant De quelle couleur sont les Blancs? Des « petits Blancs » des colonies au « racisme anti-Blancs » .
Comprendre la perpétuation des dominations et des discriminations fondées sur des bases ethniques suppose en effet de ne pas cantonner la question du racisme au sort des minorités invisibles mais de retourner le regard vers le groupe majoritaire et sa « blanchité » .
L’un des contributeurs de cet ouvrage collectif, Maxime Cervulle, maître de conférences à l’Université Paris VIII, vient de publier, aux éditions Amsterdam, un livre tiré de sa thèse, intitulé Dans le blanc des yeux. Diversité, racisme et médias, dont le projet est d’étudier « l’impact du racisme sur ceux-là mêmes qui le perpétuent » , pour reprendre les mots de l’écrivain Toni Morrison, en ne s’intéressant pas seulement aux « minorités visibles » mais aussi à la « majorité invisible » .
Un déplacement du regard qui constitue un moyen précieux pour rendre flagrantes les limites des discours de bonne conscience sur la promotion de la diversité ou d’un slogan républicain aveugle aux différences ethniques. Entretien.
Comment expliquez-vous que la thématique de la « diversité » semble moins portée par la gauche au pouvoir que par la droite chiraquienne puis sarkozyste ?
La question du racisme traverse l’ensemble des deux camps, la gauche et la droite, en les fracturant. La mise en place d’outils statistiques permettant d’identifier et cartographier les manifestations du racisme a divisé la gauche, y compris lors de la primaire socialiste lorsque François Hollande était, sur ce point, en désaccord avec Manuel Valls, favorable, alors, à ce type de statistiques. Sur la question du racisme, François Hollande a adopté une posture humaniste assez classique, mais d’un humanisme qui, en souhaitant ne pas percevoir la différence ou les différences, va jusqu’à nier les effets sociaux des processus de différenciation.
En souhaitant ne pas percevoir la race, ne pas employer le terme de race, voire l’effacer du corpus de la législation nationale et éventuellement de la Constitution, on en arrive à nier l’existence du racisme, ou tout au moins à ne pas mettre en oeuvre de dispositifs publics de réflexion et d’action contre le racisme. Le refus des « statistiques de la diversité » tend à faire disparaître la question du racisme de la statistique publique. On a beaucoup de difficultés à identifier ce que le racisme veut dire en termes socio-économiques, ce qui n’est pas le cas dans d’autres territoires. Par exemple, aux États-Unis, on sait très bien qu’être noir implique une probabilité plus élevée de vivre en dessous du seuil de pauvreté : en 2010, 27 % des personnes s’étant déclarées « noires » vivaient sous ce seuil, contre 10 % des personnes s’identifiant comme « blanches » . En France, on n’en a strictement aucune idée.
Il existe tout de même l’enquête Trajectoire et Origine, réalisée conjointement par l’Insee et l’Ined en 2008…
L’enquête TeO a été le contournement principal de ce manque et elle a considérablement contribué à la réflexion sur ce sujet, notamment en démontrant que la couleur de peau constitue un facteur significatif de discrimination, dissocié de la question de l’immigration. Mais les restrictions légales qui, depuis 1978, pèsent sur la constitution de statistiques ethnoraciales – qui permettraient d’évaluer plus avant les mécanismes croisés de discriminations fondées sur l’ethnicisation ou la racialisation – empêchent une réflexion plus large. Cette contrainte a des effets sur l’action publique et sur la recherche en sciences sociales. L’absence de catégoriel ethnoracial permettant de mesurer les effets du racisme conduit souvent à un effacement de cette question dans la recherche. Par facilité institutionnelle, on en parle peu. Rares sont les postes fléchés « sociologie du racisme » à l’université.
Un argument pour retirer le mot « race » de la législation et de la Constitution est qu’il n’a pas de fondement scientifique. Serait-il pertinent de la remplacer par le terme d’ « ethnie » ?
Non. Les termes race et ethnie désignent des réalités totalement différentes. J’utilise le terme de race au singulier, non bien entendu comme une catégorie biologique, mais pour désigner un processus social de partition de la population. Cet axe de différenciation continue à avoir une pertinence aujourd’hui dans la répartition des ressources et dans l’accès aux biens, comme dans la structuration des imaginaires sociaux. Alors que la race désigne une position assignée au sein des rapports sociaux, l’ethnicité désigne une identité culturelle, un rapport commun à une langue ou une religion, une identité positive, à soi, revendiquée. Qu’ont en commun les groupes qui sont assignés à la même position raciale ? Une expérience partagée de l’oppression.
En France, l’exercice imposé de l’euphémisme lorsque l’on parle du racisme a conduit à des glissements lexicaux entre ces deux termes. Le meilleur exemple de cela est un rapport remis à Jean-Louis Borloo en 2005, quand il était ministre de l’emploi qui s’intitulait « La lutte contre les discriminations ethniques dans le domaine de l’emploi » . Mais si on ouvrait le rapport, les termes d’ethnie ou d’ethnique n’apparaissaient pas. Il était bien question de « discrimination raciale » . Encore une fois, nous manquons peut-être d’outils pour penser l’articulation de ces deux types de discriminations, particulièrement alors que le racisme se fonde aussi désormais sur l’affirmation de différences culturelles soi-disant irrémédiables et incommensurables.
Vous reprenez, dans votre ouvrage, la formule de Kendall Thomas, selon laquelle « race est un verbe » , c’est-à-dire un processus toujours en cours. Mais comment désamorcer le risque de racialisation du débat public inhérent à l’identification des origines des acteurs sociaux ?
Peut-on vraiment penser que le débat public aujourd’hui en France n’est pas racialisé ? Je ne vais pas revenir sur les propos récents de Manuel Valls sur les Roms. Certains discours illustrent bien les formes que peut revêtir le néo-racisme culturel tel que l’a analysé le philosophe Étienne Balibar. Par ailleurs, si la mesure des discriminations fondées sur l’apparence est rendue difficile, l’identification des origines est quant à elle tout à fait commune dans la statistique publique.
Le terme « race » est à la fois le signe historique de la partition de la population et, en même temps, le seul moyen conceptuel d’identifier la persistance et les transformations de ces phénomènes de partition. Étienne Balibar disait à ce sujet, pour défendre la présence du terme dans la Constitution, qu’il faut « nommer les choses par leur nom historiquement déterminant » . Le projet de François Hollande d’effacer le mot « race » de la législation a donc quelque chose d’assez ubuesque. L’ironie veut d’ailleurs que son premier article stipule que la République « ne reconnaît l’existence d’aucune prétendue race » . Pour maintenir la protection juridique contre le racisme, on doit précisément employer le terme que l’on cherche à effacer. Cette bataille lexicale est vaine et fait oublier la lutte contre les réalités que revêt cette catégorie dans les pratiques sociales.
On comprend les limites d’un aveuglement de la république française vis-à-vis des différenciations raciales, même lorsqu’il part d’un principe humaniste qui voudrait que ces différences n’existent pas. Mais comment expliquer dès lors que, de Nicolas Sarkozy à Manuel Valls, les partisans des statistiques ethniques se recrutent dans les rangs de ceux qui défendent la conception la plus autoritaire et la moins inclusive qui soit de la République ?
S’agissant du goût de Nicolas Sarkozy pour ces questions, qui était présent bien avant la campagne de 2007, il y a quelque chose de son atlantisme qui s’exprimait, et d’une conception de l’identité assez différente de celle du républicanisme humaniste défendu par François Hollande. Le premier renvoie à une gestion managériale et essentialiste de la « diversité » , le second à un effacement pur et simple de la lutte contre les discriminations de l’agenda des priorités publiques. Néanmoins je pense qu’il existe une autre voie, entre l’aveuglement universaliste et un multiculturalisme essentialiste qui va jusqu’à calcifier les identités. Celle d’un constructivisme critique, qui permet, à mon sens, d’avoir une utilisation raisonnée du concept de race, c’est-à-dire avec un objectif antiraciste.
En quoi cela permettrait-il de constituer la « politique de la reconnaissance » que vous évoquez ?
Pour éviter un certain nombre de pièges, il faut tenir ensemble les dimensions matérielle et symbolique du racisme. La dimension matérielle se manifeste dans les rapports sociaux. Il s’agit de comprendre le racisme non comme une conduite déviante et marginale, mais comme systémique. En d’autres termes, de saisir le racisme comme une distribution inégale des ressources fondée sur une division du travail racialement marquée.
Cette question matérielle doit s’articuler à celle des enjeux symboliques – des luttes pour la visibilité, pour la reconnaissance, conduites par les minorités, sur des revendications identitaires en faveur de l’égalité. Cette articulation est une nécessité pour prévenir le risque d’une vision essentialiste de la société et des processus de racialisation qui sont à l’oeuvre.
Pourquoi vous paraît-il nécessaire d’importer le concept de blanchité, traduction de l’anglais « whiteness » , dans le contexte français ? Pourquoi, alors même qu’on manque de données et de manières d’agir sur le sort des « miniorités visibles » se préoccuper de la « majorité invisible » ?
Travailler sur la blanchité revient à étudier « l’impact du racisme sur ceux-là mêmes qui le perpétuent » , pour reprendre l’expression de Toni Morrison. Le point de départ est assez simple : le racisme en tant que système traverse l’ensemble des domaines de notre société, affecte l’ensemble de la structure sociale et donc l’ensemble des individus en son sein.
Mais la question de la façon dont les groupes sociaux situés en position hégémonique peuvent être affectés par le racisme, ou peuvent s’en trouver complices dans leurs pratiques les plus ordinaires, a été souvent écartée au profit d’une approche centrée sur les minorités. C’est une tendance assez régulière de la sociologie que de se centrer sur les groupes minoritaires ou dits « déviants » , plutôt que d’interroger le fonctionnement des groupes hégémoniques. C’est pareil sur les questions de classe : beaucoup de travaux sont publiés sur les classes populaires, peu sur la bourgeoisie ou l’élite internationale, même si cela est en train de changer.
Le concept de blanchité permet d’interroger la façon dont se pense et se construit le groupe social en position hégémonique. Cela permet de penser la dynamique du racisme de l’autre côté des rapports sociaux, d’appréhender des pratiques sociales quotidiennes qui participent de l’exclusion des minorités ethnoraciales.
La question de la blanchité a d’abord émergé dans les écrits d’auteurs africains-américains, en particulier chez W.E.B. Du Bois, l’un des fondateurs de la sociologie américaine (photo ci-contre), qui a notamment étudié la question de la reproduction du racisme par les Blancs. De quelles façons les membres de ce groupe social s’engagent-ils ou non dans des pratiques qui reconduisent le racisme ? Et cet engagement est-il conscient ? Une des interrogations centrales consiste à savoir dans quelle mesure les individus socialement perçus comme blancs, et qui à ce titre peuvent bénéficier d’avantages qui découlent du racisme systémique, ont conscience ou non de l’existence de ce racisme systémique, ont conscience ou non de percevoir des avantages immérités.
Le groupe majoritaire « blancs » est en réalité, très hétérogène, comme l’est d’ailleurs le groupe « noirs » . Mais si la blanchité désigne moins la couleur de peau blanche qu’un mode de domination naturalisé, où l’on n’a même plus conscience d’être du côté des dominants, la partie du groupe majoritaire qui est du côté des dominés sociaux appartient-il à la blanchité ?
Le terme « noir » est un terme qui unifie des identités ethniques tout à fait différentes, mais qui a permis de désigner des formes d’oppression commune dans des moments ou des territoires donnés. Au sein des black studies ou des cultural studies britanniques, qui ont travaillé sur ces questions-là, la conception de l’identité noire est à la fois constructiviste et pragmatique. Elle remet en cause l’homogénéité de cette catégorie, mais elle reconnaît le caractère absolument indispensable, notamment historiquement, de cette catégorie pour contester le racisme.
Le concept de blanchité désigne une position matérielle et symbolique dans les rapports sociaux de race. Si on comprend le racismecomme systémique, c’est-à-dire comme une distribution asymétrique de l’accès aux biens, aux ressources et à la reconnaissance, les personnes socialement perçues comme blanches peuvent bénéficier d’un certain nombre d’avantages immérités. Il s’agit donc de poser la question du bénéfice de l’inégalité pour certains segments de la société.
La blanchité s’arrime à la couleur de peau, mais c’est la construction sociale et historique de cette couleur en signe racial qui l’ancre dans les rapports sociaux. Son interprétation varie puisqu’on peut, par exemple, être interprété ou non comme blanc selon le contexte. C’est donc bien un concept lié à des cadres historiques et sociaux d’interprétation de la couleur de peau, qui vont se transformer en valeurs dans l’organisation de la société.
Des travaux américains ont étudié la fabrique historique des identités blanches, et les conséquences socio-économiques qu’a pu avoir, sur ces groupes, le fait d’être perçu, ou non, comme blancs. Le classique de Noel Ignatiev, How the Irish Became White, raconte le processus de blanchiment symbolique de la population irlandaise. L’émergence de l’identité blanche aux États-Unis, à la fin du XIXe siècle, se fait selon l’historien David Roediger, sur une sorte d’alliance entre différents groupes d’immigrés européens, qui ont revendiqué le fait d’être blanc, pour valoriser le travail salarié face à l’esclavage. Dans cette situation, les identités blanches ou noires ne désignent pas tant la couleur de peau que des positions dans une économie politique : esclavage contre salariat.
Cela repose la question de la manière dont on importe un concept américain dans le champ français. La présence de l’esclavage aux États-Unis a permis d’évacuer, dans ce pays, la question sociale telle qu’elle s’est constituée en France au XIXe siècle. L’articulation question sociale / question raciale était donc centrale dès l’origine aux États-Unis. Cette articulation ne se pose pas de la même façon en France, en dépit de la colonisation et des migrations. Est-ce que la transposition de « whiteness » en « blanchité » ne risque pas, alors, d’être incongrue ?
Je ne crois pas à la dissociation de la question sociale et de la question raciale. L’impérialisme, le colonialisme et l’esclavage ont laissé des traces profondes dans la structure sociale, économique et culturelle de la France. Comment ignorer par exemple le fait que la République a produit l’indigénat, et les codes juridiques afférents, et qu’aujourd’hui des collectifs politiques se revendiquent de cette position indigène pour contester la persistance, sous des formes renouvelées, du racisme colonial ? De la même façon, les formes contemporaines particulièrement violentes de l’islamophobie ne peuvent être dissociées de l’histoire coloniale. Si l’on suit l’idée selon laquelle nous serions dans une situation postcoloniale, c’est-à-dire au sein de laquelle persistent les effets du colonialisme, quel est l’envers persistant de la figure de l’indigène ?
[[lire_aussi]]
D’une certaine façon, le concept de blanchité renoue avec certains des écrits de Césaire ou de Fanon, qui ont pu être lus selon ce prisme dans le contexte étatsunien. Lorsque Fanon écrit en 1952, « le Blanc est enfermé dans sa blancheur » , il ouvre une réflexion sur les effets du racisme sur le groupe social en position hégémonique. L’une des voix de la sociologie française les plus importantes sur le racisme, Colette Guillaumin, traçait elle aussi, en 1972, la voie d’un tel programme. Elle notait, avec justesse, que la fixation sur « la spécificité des racismes a contribué à voiler la très réelle spécificité du racisant en abordant ce dernier dans une optique de généralisation qui excluait une définition sociologique de sa position » . Je pense que ce programme de recherche garde toute sa pertinence aujourd’hui et que la traduction française du concept de blanchité permet de rouvrir cette réflexion.
Comment désamorcer le risque d’un effet boomerang de l’idée de blanchité à travers le risque de son instrumentalisation ou de son renversement, par ceux qui évoquent, par exemple, un « racisme anti-blanc » ?
Cela pose la question de la circulation des concepts entre l’université, l’espace public et le langage courant. Il y a des effets de déplacement qui, sans doute, ne sont pas maîtrisables. Mais le concept de blanchité est d’abord un outil pour la gauche critique, ou l’université critique, pour saisir et aborder sous un angle nouveau la question urgente du racisme. Mais le livre s’adresse aussi aux pouvoirs publics, sur un certain nombre de points, qui touchent au racisme systémique et institutionnel.
Enfin, pour répondre tout à fait à votre question, le concept de blanchité est indissociable de celui de racisme systémique, qui conteste précisément la thèse d‘un « racisme anti-blanc » . Il ne faut pas confondre des actes de langage isolés avec une structure d’inégalité qui se déploie dans l’ensemble du champ social : accès à l’emploi, au logement, à l’éducation, etc. Le prétendu « racisme anti-blanc » n’est qu’un écran de fumée visant à masquer l’inégalité raciste et à la renforcer.
Mediapart, Mardi 15 octobre 2013